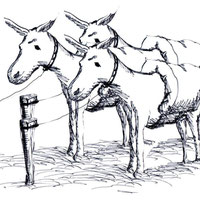Abdellatif Laâbi, « présumé né en 1942 ».
Une boutade ? Même pas. Une date de naissance au jugé, quand les autorités du protectorat se décident à généraliser l’état civil au Maroc.
Un flou qui sied à un homme qui s’insurge contre les étiquettes.
Va pour 1942.
Au commencement, Fès, donc. « Les ruelles et les cimetières. » Ville-labyrinthe où les enfants se frottent à la vie, cimetières où l’on joue au football pieds nus pour ne pas abîmer ses chaussures. Les ruelles, domaine du travail humble et patient des artisans ; de Driss, le père, artisan sellier.
« L’artisan obscur
dans l’échoppe obscure
dans le pays obscur
Picasso du silence »
Et Ghita, la mère aux yeux verts, en révolte permanente contre sa condition, féministe avant l’heure et sans le savoir.
Il fera d’elle l’héroïne de son roman Le Fond de la jarre.
Entrée à l’école franco-musulmane. Il découvre pêle-mêle la lecture, la langue française, la condition de petit colonisé. Au sortir de l’école, sur les placettes où les conteurs l’ouvrent au territoire de l’imaginaire, il contemple les paysages urbains et humains, y forge sa sensibilité. A l’indépendance, en 1956, il a quatorze ans.
Il écrit déjà. Qu’est-ce qui lui a insufflé « le mal d’écrire » ? « Mon premier choc fut la découverte de l’œuvre de Dostoïevski. Je découvrais avec lui que la vie est un appel intérieur et un regard de compassion jeté sur le monde des hommes. »
Sautons quelques étapes pour arriver à l’université, à Rabat. La section de lettres françaises manque cruellement d’aspirants professeurs, on l’y inscrit d’office.
Il rêvait d’étudier le cinéma, à défaut la philosophie. Mais va pour les lettres françaises…
En 1963, il participe à la création du Théâtre universitaire marocain. Là, entre Brecht et Arrabal, il rencontre Jocelyne, étudiante venue de Meknès, passionnée de théâtre elle aussi.
Ils se marient en 1964.
C’est alors que la tourmente politique qui l’emportera commence par un cyclone dévastateur : le massacre de milliers d’enfants qui manifestent pacifiquement à Casablanca, en mars 1965.
« Pour mille et un enfants
Effacés
d’un trait de haine
à l’aube muette
des peuples fous de parole… »
Il enseigne alors le français dans un lycée de Rabat. Le contact avec les jeunes élèves est enthousiasmant mais ne lui suffit pas. En 1966 débute « la belle
aventure » de Souffles.
Si la revue s’annonce comme poétique et l’est exclusivement dans son premier numéro, ce n’est pas un hasard. « La poésie est le vrai laboratoire de la littérature. »
Dès le numéro 2, les horizons s’élargissent : questionnement sur la culture, quelle que soit sa forme d’expression, puis peu à peu sur les problèmes sociaux et économiques qui sont le lot de la société marocaine sous le régime d’injustice et de corruption qui l’accable.
Souffles, ce sera 22 numéros en français, 8 numéros en arabe (Anfas, « souffles » en arabe), où toutes les questions qui agiteront le champ intellectuel dans les décennies suivantes sont posées.
« Cette expérience fondatrice a permis un réel bouleversement du champ littéraire maghrébin. »
Parallèlement, il s’implique dans l’action politique.
« Le pas que j’avais franchi découlait normalement de ma révolte et de mes exigences d’écrivain. Les mots de ma rébellion ne pouvaient pas être gratuits. Je devais me prendre, les prendre au mot. »
Il rejoint les rangs du Parti pour la libération et le socialisme (avatar du Parti communiste marocain), le quitte, est en 1970 l’un des fondateurs du mouvement d’extrême gauche Ilal-Amam, clandestin par la force des choses et du régime de fer.
1972, janvier. Début de l’année, début des années noires, de la chape de silence et de peur qui s’abat sur le pays.
Arrestation. Torture. Prison. En même temps que des dizaines de jeunes hommes et quelques femmes, idéalistes et révoltés par l’injustice.
En 1973, il est condamné à dix ans de prison. Une parodie de justice : les preuves « accablantes » de son entreprise de subversion, du complot qu’on l’accuse d’avoir fomenté contre le régime, sont les numéros au complet de Souffles et d’Anfas.
Et on l’enferme dans la « citadelle d’exil », à Kénitra, où il devient le prisonnier numéro 18611.
« On apposa un numéro sur le dos de mon absence »
On l’enferme. Mais se laisse-t-il enfermer ? Il ne cesse d’écrire, de se brûler aux interrogations, aux remises en question en lui, autour de lui, d’aimer. De vivre. Il ne cesse d’être libre.
« Je n’irai pas jusqu’à remercier mon geôlier, mais j’avoue que sans lui la liberté que j’ai gagnée serait restée pour moi une notion assez abstraite. Alors, dans cette affaire et malgré les apparences, qui a eu le dernier mot, de lui ou de moi ? »
Au bout de huit ans et demi, en 1980, les portes de la citadelle s’entrouvrent pour lui et quelques-uns de ses compagnons de détention, grâce à une campagne internationale en sa faveur. Il n’a rien perdu de ses exigences, de sa capacité de révolte, de son élan vers une plus grande humanité.
« La prison m’a beaucoup appris sur moi-même, sur l’étrange continent de mon corps et de ma mémoire, sur mes passions et leur tout aussi étrange labyrinthe de racines, sur ma force et ma faiblesse, mes capacités et mes limites. La prison est donc une impitoyable école de transparence. »
Cinq ans plus tard, il quitte le Maroc pour la France. Quitter ? Exilé ? Quelle sorte d’exilé est-il ?
« La distance prise avec le pays me rapproche plus de lui. Elle me permet de mieux l’inscrire dans une démarche de l’universel. L’éloignement est le nouveau prix à payer. L’écriture y gagne sa vraie liberté, et sa vérité en quelque sorte. Elle ne se conforme plus qu’à ses propres exigences. Elle ne signe plus les subversions. Elle est subversion. »
Liberté, le maître mot.
Depuis, il s’est fait passeur de mots, s’attelant à la traduction en français de nombre d’auteurs arabes, des poètes pour l’essentiel.
Et surtout, d’un livre l’autre, il développe une œuvre qui touche tous les genres littéraires (roman, théâtre, essai, livres pour enfants) mais dont le fondement essentiel reste l’humain,
« Je n’ai jamais cessé de marcher vers mes racines d’homme »
et le moyen d’expression privilégié, la poésie.
« La poésie est tout ce qui reste à l’homme pour proclamer sa dignité. »
Un livre après l’autre, il creuse son sillon particulier, d’une plume toujours renouvelée, avec le regard de celui qui sait encore s’émerveiller devant la vie, de celui qui piaffe parfois devant les limites imposées, la difficulté de dire : « Je suis à peine né à la parole ».
Un homme qui ne triche pas.
« C’est ma vie
que je mets là en mots
que je traduis en images
plus ou moins heureuses
que j’interroge, bouscule
et presse comme un citron »
P.-S. Abdellatif et Jocelyne ont eu trois enfants : Yacine, né en 1965, Hind, née en 1966, Qods, née en 1972.
Yassine Laâbi.